Quand j’entends quelqu’un dire : « Moi, je fais de la systémie », j’ai souvent envie de sourire. Pas par ironie, mais parce que, justement… la systémie, ça n’existe pas. Ou plutôt : cela n’existe plus vraiment dès qu’on essaie d’en faire un objet.
Ce mot, qu’on utilise parfois comme un label – « la systémie » – a fini par figer un mouvement vivant. Il a transformé une manière de regarder les interactions en une sorte de méthode prête à l’emploi. Comme si penser systémique revenait à appliquer un protocole ou un modèle.
Or, c’est tout le contraire : l’approche systémique, celle de Palo Alto, n’est pas un outil qu’on applique. C’est un regard. Une attitude relationnelle. Une posture d’observation et d’intervention qui nous invite à comprendre ce qui se joue dans les échanges, plutôt qu’à chercher des causes ou des coupables.
Quand le vivant se transforme en concept
Au fil des années, le mot « systémie » est devenu un raccourci commode. Il permet de se comprendre entre initiés : « On travaille en systémie », « On a fait une formation à la systémie », etc.
Mais, à force de l’utiliser, on en oublie ce qu’il recouvre : un mouvement, pas un modèle.
C’est un peu comme si l’on disait : « Je fais de la nature. » Non : la nature, on ne la fait pas, on la rencontre, on s’y relie, on la laisse agir. De la même façon, l’approche systémique n’est pas quelque chose que l’on “fait” ; c’est un cadre d’observation et d’action qui nous aide à voir les dynamiques relationnelles à l’œuvre.
Derrière cette confusion se cache souvent une envie légitime : donner un cadre rassurant à la complexité. Dans un monde où tout va vite, il est tentant de se dire qu’il existe une « méthode systémique » qui permettra de résoudre les problèmes autrement. Mais l’approche interactionnelle et stratégique de Palo Alto n’a jamais été une recette. Elle est une invitation à regarder autrement ce qui se passe – à s’intéresser à la manière dont les gens tentent de résoudre leurs problèmes, et à ce que ces tentatives produisent comme effets.
Quand “faire de la systémie” devient une autre manière de contrôler
J’ai souvent observé, dans les organisations, des managers ou des consultants sincèrement convaincus de « faire de la systémie ». Ils dessinent des boucles, repèrent les rétroactions, identifient les acteurs-clés… et pensent ainsi adopter une posture systémique.
Mais parfois, ce qu’ils font, c’est simplement déplacer le contrôle : au lieu de chercher qui a tort, ils cherchent quelle boucle est défaillante.
Le regard reste surplombant : on observe le système de l’extérieur, on cherche à le corriger, comme un mécanicien face à un moteur.
Or, l’approche systémique, dans son esprit originel, ne cherche pas à corriger le système, mais à entrer en relation avec lui. Elle suppose une position d’humilité : celle du jardinier qui observe, écoute, tente quelque chose, puis observe encore.
Ce n’est pas un pilotage, c’est un dialogue.
La différence est essentielle.
“Faire de la systémie”, c’est souvent vouloir agir sur.
“Penser systémique”, c’est apprendre à agir avec.
Un exemple concret : quand la logique technique bloque la relation
Je me souviens d’un dirigeant qui m’expliquait fièrement comment il avait « appliqué la systémie » à un conflit récurrent entre deux équipes. Il avait cartographié les interactions, mis en place des canaux de coordination, institué des réunions de régulation. Tout semblait parfait sur le papier. Mais, quelques mois plus tard, le conflit persistait, sous d’autres formes.
En y regardant de plus près, on s’est aperçu que son dispositif, très bien conçu, maintenait la distance entre les deux équipes.
Chacune se sentait encore plus observée, analysée, évaluée. Autrement dit, plus on “faisait de la systémie”, plus la méfiance augmentait.
Ce que cette expérience illustre, c’est la différence entre comprendre le système et entrer dans la danse du système.
L’approche systémique n’est pas un regard d’expert sur des relations : c’est une manière d’être dans la relation. Si vous souhaitez d’autres exemples d’application de l’approche, je vous invite à regarder les replays intitulés “Tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur l’approche systémique ” ou encore celui sur les compétences managériales pour transformer les difficultés relationnelles en opportunités par exemple.
Retrouver l’esprit de Palo Alto
Les chercheurs et praticiens de l’école de Palo Alto – Bateson, Watzlawick, Weakland, Fisch et d’autres – n’ont jamais voulu fonder une “science de la systémie”. Ils ont proposé un changement de paradigme : passer d’une logique causale (« qui a raison, qui a tort ? ») à une logique interactionnelle (« que produit cette manière d’interagir ? »).
C’est cela, l’approche systémique : un art de regarder les relations comme des boucles vivantes plutôt que comme des chaînes de causes. Une invitation à questionner nos tentatives de solution, à observer leurs effets, à ajuster nos positions sans chercher de coupable ni de vérité absolue.
Dans cet esprit, dire « je fais de la systémie » n’a pas beaucoup de sens. On ne “fait” pas de la systémie, on adopte un regard systémique sur ce qui se joue. Et ce regard ne s’enseigne pas comme une technique : il se cultive, par la pratique, l’écoute et la curiosité.
Systémie ou approche systémique : une nuance qui change tout :
| Systémie | Approche systémique |
| Fige le concept en discipline, en “chose” qu’on applique | Reste un mouvement, une manière de penser et d’agir |
| Posture d’observateur externe | Posture d’acteur-participant |
| Recherche de cohérence, de structure | Recherche d’ajustement, d’équilibre relationnel |
| Vise à “corriger” le système | Vise à comprendre et accompagner ses dynamiques |
| Langage technique | Langage du vivant, de l’interaction |
Travailler avec le vivant plutôt que sur le système
Ce que nous dit l’approche systémique, c’est que le système – c’est-à-dire le collectif humain – n’est pas un objet manipulable. C’est un ensemble d’interactions, d’émotions, d’habitudes et de protections. Chaque fois qu’on tente de le “corriger”, il nous répond : il résiste, s’adapte, se réorganise.
D’où cette idée essentielle : on ne change pas un système, on change la relation qu’on entretient avec lui. C’est en modifiant nos propres gestes, nos mots, nos manières d’écouter, que quelque chose peut bouger. C’est tout le sens de la métaphore du jardinier relationnel : on ne force pas la croissance, on crée les conditions du vivant. Ainsi, l’approche systémique n’est pas un ensemble d’outils à appliquer. C’est un art de la présence et de l’ajustement : observer sans juger, intervenir sans forcer, faire avec ce qui est là.
Pourquoi ce glissement de langage compte vraiment
Certains diront que “systémie” ou “approche systémique”, c’est du pareil au même. Mais les mots façonnent notre manière de penser.
– Quand on parle de “systémie”, on fige.
– Quand on parle “d’approche”, on se met en mouvement.
Ce glissement sémantique dit beaucoup de notre rapport au changement. Les organisations aiment les modèles : ils rassurent, donnent l’impression de maîtriser la complexité. Mais les relations humaines échappent toujours aux modèles. Elles se réinventent, se déplacent, surprennent. Adopter une approche systémique, c’est donc accepter de perdre un peu de contrôle, pour mieux accueillir la dynamique du vivant. C’est passer d’une logique d’ingénierie à une écologie des relations.
En guise d’ouverture
Alors oui, la “systémie” n’existe pas. Et c’est une bonne nouvelle. Parce qu’elle nous rappelle que le réel n’entre pas dans les cases que nous construisons pour le penser. Que nos relations, nos équipes, nos tensions, sont des formes vivantes, mouvantes, imprévisibles. Et que c’est là que réside la richesse du travail d’accompagnement : dans cette capacité à danser avec la complexité, sans prétendre la dompter.
Et vous, qu’évoque pour vous cette distinction entre systémie et approche systémique ? La trouvez-vous utile, ou purement sémantique ? Je serais curieux de lire vos réactions.
Je reste disponible pour échanger avec vous sur Linkedin. Pensez à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir les prochaines invitations (inscrivez-vous ici, lien en tout bas de page).
Olivier


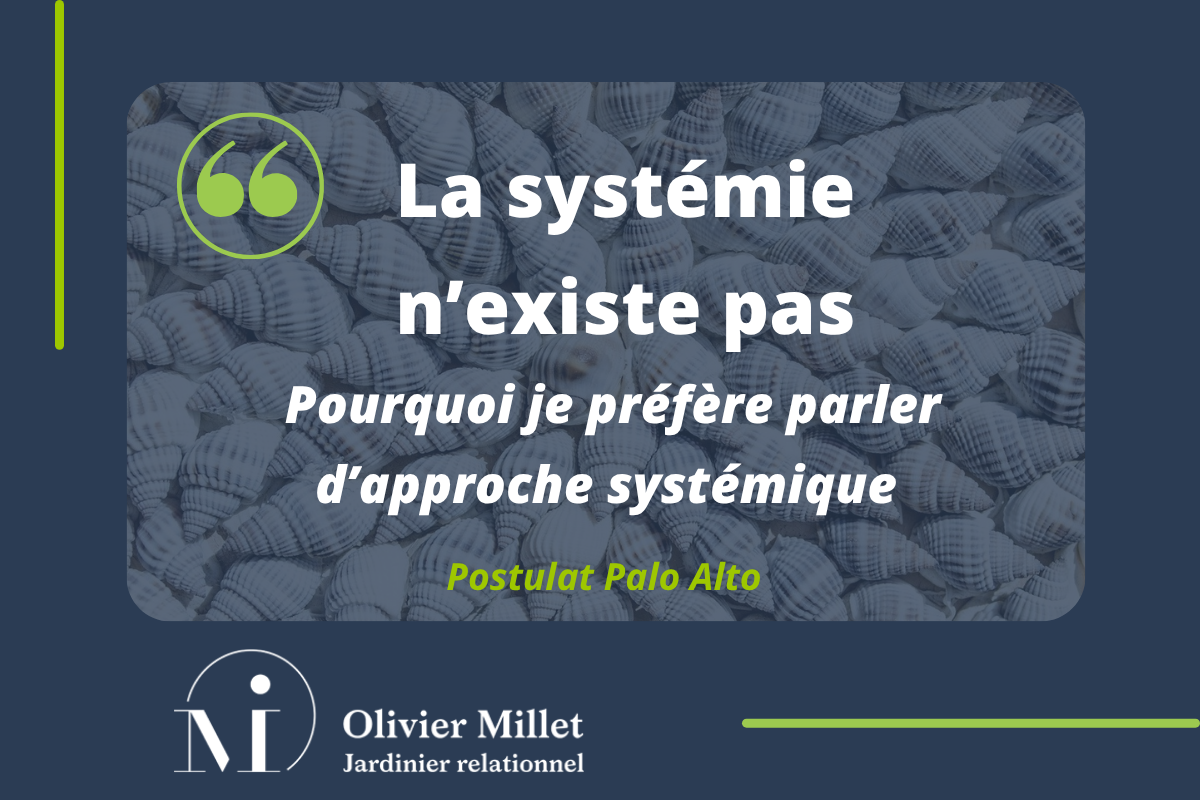

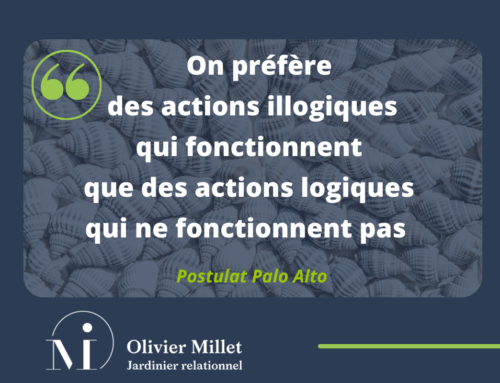


Leave A Comment